CAPITALISME ET TOTALITARISME
Publié par admin on Fév 1, 2015 | 0 commentaire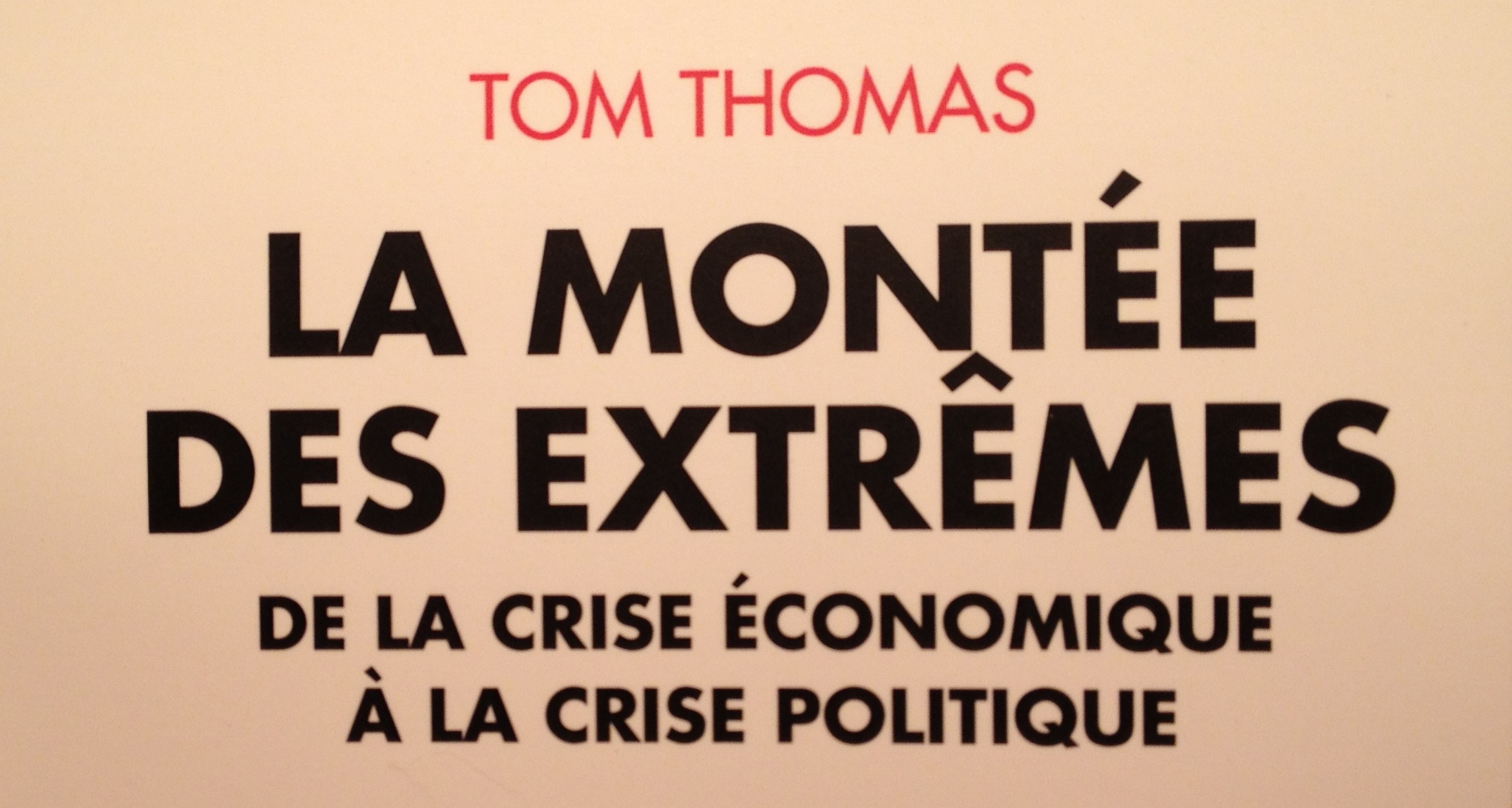
CHAPITRE 2 du livre de Tom Thomas « La montée des extrêmes »
Cette crise ne crée pas la tendance au totalitarisme, elle la renforce. Je n’ignore pas ce que ce mot a de flou dans le langage courant, puisqu’il a été utilisé pour désigner plusieurs occurrences dans l’histoire moderne. Avant 1945 par exemple, il désignait les divers fascismes, puis, par un rapide retournement dû notamment à la guerre froide, le soi-disant communisme stalinien4. Mais flou aussi, et même surtout, parce que, on le verra plus loin, les idéologues qui ont popularisé cet usage – telle Hannah Arendt, souvent citée comme référence en la matière – n’en ont fait qu’un concept bâtard, qui n’oppose que deux formes, deux modes de fonctionnement de l’État du capitalisme, sans voir ce qui les relie profondément au-delà de cette opposition. Ils ne désignent par « totalitaire » qu’une domination étatique ouvertement et pleinement despotique5, policière, sous la férule brutale d’un parti unique et de son chef. Ils présentent comme antagoniques totalitarisme et démocratie bourgeoise alors qu’il ne s’agit que de deux formes politiques de la même domination du capital (c’est-à-dire des exigences de sa valorisation, qui est son existence), de la façon dont son État contribue à sa reproduction, son accumulation.
Ce qu’on peut nommer précisément totalitarisme, c’est la subsomption (soumission, assujettissement des corps et des esprits) totale des individus au capital, à laquelle ils ne peuvent échapper que par une révolte radicale. Totale ne veut donc pas dire absolue, sans opposition, sans recours. C’est dire qu’elle s’exerce sur les individus à travers l’ensemble des rapports sociaux du capitalisme, pas seulement de l’extérieur au moyen de la superstructure politique, idéologique, juridique, mais aussi directement dans la production et dans toutes leurs autres activités (leurs loisirs par exemple). Et si, effectivement, le rôle de l’État devient de plus en plus essentiel dans l’exercice et l’organisation de cette subsomption, cela est en rapport avec l’évolution historique du mode de production, avec l’accentuation de ses contradictions qu’implique l’accumulation du capital. Il s’agit d’un processus historique. En ce qui concerne l’État, il n’amène pas à opposer l’État totalitaire à l’État dit démocratique de façon antagonique, mais est plutôt constitué du prolongement de l’un dans l’autre, avec possible réciprocité, comme on l’a vu par exemple en Europe en 1945 et après la mort de Franco.
D’ailleurs la tendance de l’État d’être l’instrument du totalitarisme ainsi compris, c’est-à-dire d’être totalitaire, gérant tout, s’occupant de tout dans tous les domaines de la vie sociale, dépossédant les individus de leur puissance sociale, lesquels alors, évidemment, ne sont plus rien, dépendent de l’État, est inhérente à son essence.
Rappelons en effet que l’État est un produit en même temps qu’un organisateur du MPC. Il en est un produit nécessaire parce que les individus privés poursuivent aveuglément leurs intérêts privés, séparés, et le plus souvent antagoniques, donc ne peuvent pas s’associer directement, former société par eux-mêmes. Il en est aussi un organisateur puisqu’alors il faut bien qu’un appareil hors d’eux, au-dessus d’eux, réunisse et impose les conditions générales de la reproduction de la société que ces individus, n’étant pas associés, ne peuvent pas réunir eux-mêmes. Ce rôle doit évidemment évoluer au fur et à mesure des développements et évolutions de l’accumulation capitaliste, de la dépossession croissante des prolétaires des conditions de leur travail et de leur vie, de la concentration du capital, de l’accroissement de ses contradictions qui en résulte (tendance à la baisse du taux de profit et des valeurs d’échanges, et, bien sûr, antagonismes de classes), du caractère de plus en plus social de son fonctionnement, lequel nécessite de produire, organiser et mettre en œuvre un très complexe « travailleur collectif », une mobilisation centralisée des sciences et des techniques ainsi que des financements. On ne retracera pas ici l’histoire de cette évolution, sinon pour seulement rappeler qu’elle concerne aussi bien les conditions économiques que sociales de la valorisation du capital, cette condition fondamentale de l’existence et de la reproduction de la société capitaliste. Qu’elle concerne, par exemple, aussi bien la prise en charge par l’État de plus en plus d’investissements (infrastructures, subventions et aides multiples, fourniture de crédits, nationalisation des pertes, etc.), que, autre exemple, la reproduction et l’entretien de la force de travail (formation, logement, santé, prise en charge d’une partie des salaires, etc.), en même temps que son encadrement syndical (voir plus loin) et policier afin de limiter les luttes de classes à l’intérieur des nécessités de la valorisation. Sans oublier l’appui à la conquête des marchés, l’expansion impérialiste, les guerres, etc.
Cette évolution historique qu’est l’intervention de plus en plus forte et élargie de l’État à tous les domaines, s’accompagne évidemment de son grossissement permanent en un conglomérat d’une multitude d’appareils politiciens6 et bureaucratiques à tous les échelons (locaux, centraux, intermédiaires), en dessous desquels le citoyen n’est, au mieux qu’un « usager », voire un « assisté », soumis, déresponsabilisé, dépossédé.
Dans une crise gravissime telle que l’actuelle, ce rôle des États doit encore s’accroître considérablement7. On le voit bien aujourd’hui tant leurs interventions financières, sociales, guerrières sont massives, tant les capitalistes et les peuples leur réclament, se tournent vers eux comme l’ultime secours.
L’État ne peut vouloir et tenter de ne faire qu’une chose : faire perdurer, reproduire la société capitaliste. Donc relancer la croissance, c’est-à-dire la reproduction élargie, la valorisation du capital. Cela implique en particulier, il faut y revenir ici, de développer, dans un maximum tolérable par les travailleurs, l’extraction de la pl sous sa forme absolue, puisqu’elle ne peut plus guère augmenter sous sa forme relative. Parmi les multiples moyens que l’État met en œuvre pour cela, avec la collaboration du patronat, des partis politiques parlementaires et des principaux dirigeants syndicaux (voir plus loin), on peut citer : allongement de la durée du travail, baisse des revenus des travailleurs, flexibilité et précarité. L’allongement de la durée du travail se voit nettement dans le recul constant de l’âge du départ à la retraite, ou encore dans les « accords de compétitivité » par lesquels, contre une garantie incertaine et très provisoire de maintien de l’emploi, voire d’une partie seulement de l’emploi, les horaires de travail sont augmentés, à salaires constants, voire abaissés, et les jours de congé diminués. Le gel des salaires se généralise, malgré l’inflation et l’augmentation des impôts et taxes, tandis que les salaires indirects (les prestations sociales) se dégradent en même temps que les cotisations des entreprises au nom, toujours, de l’impérieuse compétitivité (terme effectivement plus présentable que de dire l’impérieuse nécessité des profits et de l’entretien du mastodonte politico-étatique). La flexibilité comme la précarité des contrats de travail permettent d’augmenter son intensité en supprimant les « temps morts », tout en remplissant les autres de tâches accrues. Par exemple, le système « overtime » inauguré par Toyota consiste ainsi à augmenter automatiquement la journée de travail « si les cadences ou les critères de qualité n’ont pas été respectés »8. L’imagination des managers est sans limites pour créer des prolétaires « low costs », et l’État leur donne un cadre juridique ad hoc. Un « must » en matière de flexibilité sont les contrats de travail « zéro heure » à la mode chez les patrons anglais : « Ils ne mentionnent aucune durée minimale de travail, ni aucune indication d’horaires. Avec ce statut les salariés restent à disposition de leur employeur comme s’ils étaient d’astreinte en permanence. Le nombre d’heures qu’ils effectuent varie d’une semaine à l’autre en fonction des besoins de l’entreprise […] l’employeur n’a aucune obligation de fournir ne serait-ce qu’une seule heure de travail […], mais il peut interdire à ses salariés de travailler en même temps pour une autre entreprise, afin qu’ils soient totalement disponibles […] il n’y a bien sûr ni congés payés, ni arrêts maladie… »9.
Ce faisant, l’État, non seulement accentue sa tendance séculaire au totalitarisme, mais il le fait sous des formes de plus en plus coercitives et brutales. C’est là une caractéristique essentielle de la situation que cette crise révèle. Il faut rappeler en effet que tant que l’extraction de la pl était surtout corrélée aux hausses de productivité, donc sous sa forme relative, cette tendance était relativement pacifique – du moins dans les métropoles impérialistes – du fait que le peuple, comme anesthésié dans sa majorité par la hausse de son niveau de vie matériel, ne remettait nullement en cause le capitalisme. Ce qui, en particulier, laissait libre cours à l’accentuation de la subsomption réelle10 des prolétaires au capital induite par le développement de la machinerie (et donc aussi du capital financier), inhérent aux hausses de productivité. La propriété des conditions de la production de leur vie se présentait de plus en plus en face d’eux comme possession « des puissances intellectuelles de la production »11 et comme propriété financière. Ce renforcement des rapports de dépossession et de domination12 qui sont l’essence du capital passait au second plan. Celui-ci pouvait donc se reproduire relativement tranquillement, et l’État, dans cette situation de relatif consensus social, se présenter comme démocratique et comme moyen d’améliorer la condition (matérielle) ouvrière.
Plus la subsomption des prolétaires au capital est forte, plus l’est également leur dépendance à l’État qui s’est accaparé corrélativement, avec leur consentement majoritaire, passif, voire même voulu, leur pouvoir social13. De lui, qui s’occupe de tout, emplois, revenus, logement, santé, alimentation, loisirs, sécurité, éducation, vie sexuelle, etc., les dépossédés sont portés à attendre tout. Aussi dire que l’État est une puissance de plus en plus extérieure aux individus au fur et à mesure qu’il les dépossède de leur puissance, n’est pas dire qu’il est loin d’eux. C’est dire qu’il doit s’occuper de tout à leur place. Il doit donc s’introduire à l’intérieur de la société civile, s’y insinuer jusque dans ses moindres recoins pour y mettre en œuvre sa toute-puissance. Il s’y rend indispensable, il l’étatise14. Son activité tentaculaire tend à ce qu’il n’y ait plus, en quelque sorte, qu’une seule société-État. Ce qui était la formule de Mussolini (« tout pour l’État, rien hors de l’État, rien contre l’État »). Mais cette étatisation totale ne supprime en rien les divisions de la société en classes, en situations et intérêts antagoniques. Elle ne peut en réalité qu’être une coercition, un totalitarisme de forme fasciste, une pénétration de la société par une puissance qui l’étouffe. L’extériorité de l’État par rapport à la société civile semble abolie parce que celui-ci entreprend d’abolir la société civile, alors qu’elle ne peut l’être réellement que si la société civile abolit l’État.
À ce stade de l’exposé on peut tirer une première conclusion : l’État totalitaire correspond à un capital développé à un haut niveau de sciences appliquées à la production, de machinisme, de productivité. C’est à ce stade historique que les prolétaires sont dépossédés et dominés totalement par le capital et son État. L’un leur apparaît comme puissance obscure, inaccessible (science, machinerie sophistiquée, finance, marché mondial), l’autre comme la puissance qui peut agir en leur nom et les protéger des abus du premier. Ils s’adressent à lui, par la voie électorale, les manifestations de rue, les grèves, voire les émeutes, pour qu’il améliore leur situation, rétablisse le plein emploi, et pour beaucoup d’autres choses encore. Mais l’État ne peut rien faire aujourd’hui de tout cela compte tenu de la situation de sénilité du capitalisme révélée par la crise actuelle. Il ne peut que renforcer son hégémonie totalitaire pour obliger le peuple à supporter les dégradations, toujours plus amples et catastrophiques, par lesquelles, et seulement par lesquelles, le capital peut se survivre.
Une deuxième conclusion est également possible. Elle est de constater que l’État de type fasciste, le seul que les idéologues bourgeois qualifient de totalitaire (le stalinisme n’étant pour eux qu’un fascisme), n’est pas, dans son essence du moins, fondamentalement différent de l’État dit démocratique au stade du capitalisme moderne. Il est moins une rupture par rapport à lui, qu’une mutation qui en exacerbe les attributs, fondés sur la totale dépossession et domination des prolétaires, dans le même but de la reproduction de la société capitaliste dont il a la charge.
Cette mutation est d’ailleurs une tendance facile à constater de l’État dit démocratique lui-même.
D’abord, il est utile de rappeler quelles sont les bases sur lesquelles est fondée l’idéologie selon laquelle l’État pourrait être l’instrument capable de satisfaire l’intérêt général, et, notamment, celui du peuple. Car ces bases sont réelles, même si cette réalité est superficielle, seulement l’apparence des effets des rapports d’appropriation capitalistes. Ces rapports apparaissent à la surface comme les soi-disant lois économiques édictées par les « experts » bourgeois. Lois que Marx appelait, pour les caractériser, « fétichisme de la marchandise »15. Fétichisme en ce que ces lois attribuent un pouvoir étrange, tel celui d’un fétiche, aux marchandises. Plus précisément aux diverses formes que revêtent ces simples choses lorsqu’elles circulent, s’échangent sous des formes diverses telles que les prix, les salaires, les profits, la monnaie, etc. Ainsi ce seraient les rapports entre lesquels s’échangent les marchandises, rapports purement quantitatifs, qui formeraient l’économie et dont pourraient alors rendre compte des lois de type mathématique. Or, évidemment, les marchandises ne sont que les produits des travaux humains, mais, et c’est là le fond de l’affaire, effectués dans certains rapports sociaux spécifiques : la forme marchandise est celle que revêtent ces travaux dans le rapport d’appropriation de la propriété privée généralisée des moyens de production. Elle est la manifestation, l’effet de ces rapports, leur apparence à la surface du mode de production capitaliste. Le fétichisme de la marchandise consiste donc à prendre des rapports entre des choses comme déterminant de prétendues lois économiques, au lieu qu’il s’agit de rapports sociaux entre les hommes (et donc, comme le disait Marx, non pas d’économie, mais d’économie politique). En apparence il y a l’argent, les prix, les profits, etc. En réalité il y a la valeur (la quantité de travail social que contient chaque marchandise) et les lois capitalistes de la valorisation. Mais tout cela est masqué par les formes apparentes16 (l’apparence existe néanmoins, l’erreur est d’en ignorer l’essence). Ce « fétichisme de la marchandise », qui met le monde à l’envers, prend les effets pour les causes, l’apparence pour l’essence, est ainsi à la base de l’idéologie bourgeoise. Comme toute idéologie elle ne fait pas que tromper, elle ne manifeste pas seulement l’ignorance de ses porteurs, elle la motive, la développe en la présentant comme « science économique », et elle suscite effectivement des comportements (d’investissements, d’exploitation, de luttes salariales, etc.), des projets politiques, notamment ceux qui servent de base aux extrémismes populistes. Sans le fétichisme de la marchandise il ne pourrait pas y avoir de fétichisme de l’État.
Car effectivement le fétichisme de la marchandise se double aussitôt de celui de l’État, selon lequel celui-ci pourrait servir un supposé « intérêt général » parce qu’il aurait la capacité de soumettre le capital « au service de l’Homme », selon l’expression à la mode chez les idéologues de gauche (c’est-à-dire de l’aile gauche de la bourgeoisie). Illusion qui ignore évidemment que l’État est un produit inhérent au système capitaliste, dont le rôle est, et ne peut être, que d’œuvrer à sa reproduction, donc, notamment, à la valorisation du capital. Elle repose nécessairement sur le fétichisme de la marchandise puisque c’est lui qui, faisant croire que l’économie est faite seulement de rapports entre des choses, entre leurs quantités, permet d’imaginer que des États, avec leurs experts, puissent diriger l’économie, décider de la croissance comme de la répartition des richesses, puisque des quantités, ça peut se calculer, se réguler, se répartir.
Ce double fétichisme, qui trouve ses fondements dans des apparences, superficielles donc, mais bien réelles néanmoins, constitue le socle de l’idéologie étatiste, et aussi, plus généralement, un socle de l’idéologie bourgeoise, sur lequel peut se développer toute une propagande, d’autant plus massive que la haute bourgeoisie domine entièrement les moyens matériels, de plus en plus sophistiqués, de la diffusion des idées et des informations. Tous les grands médias sont la propriété de l’État et d’un petit nombre de capitalistes, qui stipendient les journalistes et intellectuels qui leur conviennent. Ils ont pour fonction de faire croire que le capitalisme, s’il peut être amélioré (ce qui leur fait prendre parfois une attitude superficiellement critique qui fait « démocratique », « liberté d’opinion », et semble les parer « d’indépendance »), est néanmoins indépassable. Il s’agit aussi de promouvoir partout, tout le temps, par tous les moyens de la « communication » (ensemble de techniques sophistiquées de manipulation), des pensées et comportements conformes aux nécessités du capitalisme, développant l’idéologie bourgeoise à travers toutes sortes de « spectacles » pour reprendre le terme de Guy Debord, discours, mises en scène, événements, faits divers, campagnes de presse, jeux, etc.
Pour ne citer qu’un exemple parmi les centaines qui s’offrent à nous, prenons le sport (quoi de plus apolitique au premier abord ?) puisque le peuple brésilien a récemment déclenché la première protestation de masse contre cet élément du système capitaliste. C’est, bien sûr, que le sport est très visiblement et outrageusement une affaire d’argent. Et les manifestants brésiliens protestaient, à partir d’une hausse des prix des transports en commun, contre les milliards sortis des poches des travailleurs (via la publicité et les impôts notamment) et gaspillés pour l’entreprise football, alors qu’ils souffrent de manques criants en hôpitaux, écoles, logements, etc. Mais ces milliards soutirés ne sont que la face visible de l’usage du sport dans le monde capitaliste. Son autre face, la plus essentielle, est souvent décrite comme celle d’être un « opium du peuple », une distraction au sens propre (détourner l’attention, faire oublier l’ennui, la peine, faire rêver). Mais ce n’est pas qu’une distraction qui se contente de faire évader un instant le spectateur de son existence. Ce n’est pas une distraction du tout même, si on comprend que le sport dans le capitalisme a pour fonction d’intégrer, et non pas distraire, le spectateur dans ce monde, d’entretenir et faire prospérer chez lui l’idéologie et les comportements capitalistes qui l’y incrustent et le lui font accepter.
Ainsi ce sport développe le chauvinisme. Il valorise aussi l’idée et les pratiques que tout est bon, tricheries, mensonges, dopage, violence, pour accaparer le plus possible d’argent. Y compris s’abrutir dans une mono-activité hyperbornée, exagérément physique, depuis son jeune âge, quitte à ruiner son corps en plus de son intellect laissé en friche. Plus haut, plus vite, plus loin, plus de muscles… et alors ? Ce n’est là offrir qu’un spectacle de mercenaires qui n’enrichit en rien, au contraire, ceux qui s’en font les fans. Spectacle qui cultive la passivité des spectateurs, ou, pire encore, en amène certains à se livrer à une activité quasi animale, faite de cris, de simagrées, voire de violences imbéciles. Il ne s’agit évidemment pas pour la bourgeoisie que leur temps de loisirs puisse être un temps de conquête et de pratique active de qualité supérieure qui développerait leur humanité, leur capacité à maîtriser la construction de leur vie, à enrichir leurs rapports sociaux. Il s’agit, au contraire, de développer un temps qui contribue à leur aliénation, qui soit organisé et rempli pour et par les intérêts du capital. Des spectateurs vocifèrent « on a gagné » quand lui seul a gagné. Entendre cela doit être une vraie jouissance pour la bourgeoisie ! Bref, parmi bien d’autres activités qualifiées d’apolitiques (par exemple les activités dites culturelles ou de loisirs) ou hors champ de la domination du capital (qui ne serait, soi-disant, que dans l’économie), le sport capitaliste est un parfait exemple de véhicule idéologique et pratique contribuant à la domination pacifique du capital en renforçant chez les travailleurs dominés et dépossédés cette part d’idéologie et de comportements inhérents au fait qu’ils sont des agents du capital avant d’en être, dans certaines circonstances, les fossoyeurs. Et contribuant aussi à ce que cette domination soit de type totalitaire depuis que les États ont pris en main l’organisation systématique du sport à cet effet – ouvertement donc depuis les Jeux olympiques de Berlin, 1936, dont le Japon aurait à son tour été l’organisateur en 1940 s’il n’y avait pas eu la guerre.
Face à la grande bourgeoisie qui s’efforce de maîtriser17 tout l’espace, tout le temps, à tous les moments de la vie quotidienne, le « citoyen », autre création de l’idéologie bourgeoise, n’est plus que jamais qu’un double juridique purement imaginaire de l’individu concret, n’existant que le temps de mettre un bulletin dans l’urne par lequel il n’a qu’à choisir ceux qui lui feront les poches, organiseront sa domination et sa dépossession par l’État et les capitalistes18. Il l’est en effet d’autant plus aujourd’hui que cette domination est totalitaire, et que la bourgeoisie dispose de puissants moyens pour orienter quasiment à sa guise le vote de ces citoyens. Ainsi, exemple parmi d’autres, en organisant d’intenses et incessantes campagnes médiatiques pour exciter les peurs multiples dont le peuple est particulièrement saisi en situation de crise, et s’en servir pour le diviser en stigmatisant les étrangers, ainsi que pour justifier le développement constant de politiques dites sécuritaires permettant de renforcer le contrôle et la répression des « classes dangereuses ». Les élus sont d’ailleurs dépendants des puissances qui financent les très coûteuses campagnes électorales, et sont même aisément corruptibles puisque leur première motivation est en général de faire carrière et gagner de l’argent.
De fait il faut aussi comprendre parmi les caractéristiques de l’évolution du capitalisme vers le totalitarisme, le développement de partis et syndicats dits de gauche prétendant représenter et faire valoir les intérêts spécifiques des prolétaires, et plus largement ceux du peuple des salariés, cela par le moyen de l’influence qu’ils auraient sur l’État, par voie légale (grèves, et surtout, in fine, élections). Ils sont progressivement devenus de véritables appendices de l’État, des bureaucraties professionnelles extérieures à ceux qu’elles prétendent représenter, étouffant, édulcorant, réprimant systématiquement la pointe avancée de leurs luttes afin de les maintenir dans les bornes des exigences de la croissance, c’est-à-dire de la valorisation du capital. Tant que les gains de productivité étaient suffisants pour permettre une certaine élévation du niveau de vie des masses, ces organisations pouvaient avoir une forte influence sur elles en négociant le partage de ces gains avec le capital. Celui-ci de son côté, trouvait avantage à cette collaboration qui limitait la lutte de classes à cet objectif, lequel, même dans les moments où cette dernière était la plus rude, ne remettait pas en cause le capitalisme, assurait finalement l’attachement des travailleurs au capital, et stimulait même son développement, malgré les récriminations de patrons particuliers devant les concessions qu’il leur arrivait de devoir faire sur ordre de l’État (gérant des intérêts du capital en général), en permettant l’augmentation de la consommation et en stimulant davantage la mécanisation.
Cette politique dite « réformiste » ou « social-démocrate » (prétendant permettre une amélioration progressive du sort des travailleurs dans le capitalisme) trouva son plus fort développement en Europe pendant les « Trente Glorieuses » d’après-guerre. Évidemment elle nécessitait d’associer à l’État les organisations social-démocrates. Ce qui fut fait par leur intégration progressive dans la pléthore des appareils chargés de la gestion et de la reproduction de la société capitaliste. Depuis les mairies jusqu’aux Parlements et ministères, en passant par une multitude d’organismes publics ou parapublics, des dizaines de milliers de postes, bien souvent des sinécures, sont ainsi occupés par des politiciens de gauche et syndicalistes professionnels qui cogèrent la reproduction du capital en tant que supposés représentants des besoins populaires (ce qui, dans la situation actuelle du capitalisme, signifie négocier leur degré de dégradation sur le thème : mieux vaut moins que beaucoup moins, et mieux vaut beaucoup moins que pire encore. Nous y reviendrons).
Pour prendre l’exemple des appareils syndicaux en France, on peut se référer au volumineux et documenté rapport Perruchot19. On y apprend notamment l’existence d’une extraordinaire myriade d’organismes paritaires, pour la plupart inconnus du public, et assez souvent bidons, sinon comme sources de financement des activités syndicales20 et des permanents qui y siègent. Sources qui s’ajoutent à celles, mieux connues, des postes d’administrateurs à la Sécurité sociale, l’Agirc, l’Arcco, la CNAF, les organismes du 1 % logement, Pôle emploi, etc., à celles des Comités d’entreprise (rien qu’à EDF, 4 000 permanents au CE !), au financement par l’État de nombreux permanents d’organismes de formation gérés par les syndicats (rien que pour la Fonction publique 28 000 équivalents temps plein selon le rapport, 17 000 selon les syndicats !), ainsi qu’au financement par le patronat via l’achat de pages de publicité dans les journaux syndicaux. À quoi s’ajoutent encore le paiement d’heures pour activités syndicales, la mise à disposition de matériels, de locaux, et bien d’autres sources encore que détaille ce rapport.
Tant et si bien qu’en considérant l’ensemble de toutes ces aides pour les activités des syndicats de salariés, tant dans le secteur privé que public, ce rapport aboutit à la conclusion suivante (approximative tant, dit-il, tout cela est opaque) :
Sur un coût annuel des activités syndicales de 3,8 à 3,9 milliards d’euros, les cotisations (nettes du cadeau fiscal de 66 % des cotisations brutes qui est comptabilisé par ce rapport comme aide de l’État) n’en représentent que 3 à 4 %. Tout le reste provient de financements par les employeurs publics et privés (pour 3,5 milliards, soit 90 %), du « paritarisme » (2 %), de subventions publiques (4 à 5 %).
Certains diront que ce sont là « des conquêtes ouvrières », des concessions et de l’argent arrachés au capital, qui facilitent l’activité syndicale pour le plus grand bien des travailleurs. Oui, mais quelle activité ? Car il y a l’autre face de la médaille, aujourd’hui bien plus déterminante pour caractériser cette activité, qui est que la pieuvre étatique a avalé les appareils dirigeant les syndicats. Dis-moi qui te paie et je te dirais qui tu sers ! Quand il n’y a que 5 à 8 % de travailleurs syndiqués, il est certes évident qu’ils ne peuvent pas financer annuellement près de 4 milliards d’euros. Mais il est tout aussi évident qu’alors, avec moins de 5 % de ressources propres, les syndicats de travailleurs ne sont ni « libres » ni « indépendants » du capital et de son État. Cette vaste bureaucratie syndicale doit en fait être aujourd’hui considérée comme faisant partie d’un quasi appareil d’État (la multitude d’organismes évoqués ci-dessus), dans lequel elle cogère la force de travail avec lui et le patronat21. La perpétuation de son existence en est sa récompense. Comme cet appareil permet à beaucoup de ses membres (il n’est évidemment pas question ici des militants qui se battent durement sur le terrain avec abnégation et au risque de la répression) l’accès à des activités bien moins pénibles que celles des travailleurs qu’ils prétendent représenter bien que 92 à 95 % de ceux-ci n’adhèrent pas, il est inéluctable que, comme toute bureaucratie d’ailleurs, elle ait pour premier souci de conserver, et si possible d’élargir, ses avantages et prérogatives, bref de se perpétuer. Elle doit pour cela chercher à obtenir quelques miettes pour sa clientèle, les représentés. Elle doit donc s’appuyer sur leurs luttes pour arracher quelques concessions aux représentants du capital, donner l’impression qu’elle les y oblige, s’oppose à eux. Mais elle doit aussi, pour conserver les avantages et prérogatives que lui ont consentis ces représentants, les assurer de sa capacité à contrôler ces luttes afin qu’elles n’aillent pas jusqu’à remettre en cause leurs positions, et encore moins l’État qu’elle cogère. D’ailleurs elle ne rate jamais l’occasion que peut lui fournir un mouvement gréviste important, par exemple mai-juin 68, pour monnayer les limites dans lesquelles elle a réussi à le contraindre contre l’obtention d’un élargissement des droits syndicaux, c’est-à-dire essentiellement de ses avantages et prérogatives. Que les prolétaires aient, dans leur majorité, accepté cette situation dans laquelle cette bureaucratie, un pouvoir hors d’eux, décide le plus souvent dans leur dos, à leur insu, à leur place, et selon ses propres intérêts de perpétuation, tient en partie à l’ignorance où ils sont de tout ce qu’elle fait, mais surtout à l’idéologie de ce que l’on peut appeler « le vieux mouvement ouvrier » dont on reparlera plus loin. Quoi qu’il en soit, on a, avec la bureaucratisation et l’intégration des syndicats comme un des appareils de l’État, un exemple significatif de l’avancée du système capitaliste dans le totalitarisme.
Un autre exemple est celui de l’extension des pouvoirs attribués à des organismes pas même élus qui ont achevé de reléguer les Parlements et autres à un rôle de moulins à paroles et de répartition des sinécures. Par exemple en France, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la Banque de France supplée par la BCE, et bien d’autres de moindre notoriété, tandis que dans les ministères ce sont les hauts fonctionnaires qui exercent l’essentiel du pouvoir (avec le relais des préfectures), ainsi qu’évidemment dans les appareils policiers et militaires. Sans oublier les pouvoirs confiés aux instances européennes, lesquelles sont un summum de non démocratie. Et s’y ajoutent encore les organismes internationaux, tels l’OTAN ou le FMI pour les plus connus. À tel point que « la plupart des décisions échappent aujourd’hui à l’espace du vote »22, ou qu’un député PS peut affirmer : « avant j’étais dans l’opposition, je ne servais à rien ; aujourd’hui je suis dans la majorité et je ne sers pas à grand-chose »23. Et quand, par extraordinaire, on consulte le peuple sur une question importante, sa volonté est immédiatement bafouée si elle ne convient pas aux puissants, comme en témoigne par exemple l’annulation de celle exprimée clairement contre le projet de Constitution européenne de 2005, malgré l’intense campagne médiatique menée en faveur de son adoption. Pire, quand, grâce à quelques « lanceurs d’alerte » courageux, ou plutôt en l’occurrence téméraires, on découvre de temps à autre l’ampleur de la surveillance policière sur des milliards d’individus (système PRISM et autres), ou certains des agissements frauduleux ou plus ou moins criminels que, bien que soi-disant démocratiques, les États cachent soigneusement aux citoyens malgré leur importance (par exemple les câbles diplomatiques révélés par Wikileaks), ils sont poursuivis et condamnés au lieu qu’ils devraient être félicités. Le mensonge est aussi monnaie courante pour berner l’opinion publique, comme en témoigne, par exemple, la légende des « armes de destruction massive » utilisée pour justifier les guerres d’Irak et leur million de morts (mais cela Goebbels l’avait déjà théorisé).
Le contrôle et l’espionnage des individus « libres » sont maintenant partout, à tout propos. Il suffit de marcher dans la rue, d’entrer dans un bâtiment, de prendre un transport en commun, pour être la cible d’une caméra de surveillance, d’utiliser une carte de crédit ou internet pour que vos relations, opinions, centres d’intérêt soient relevés et contrôlés, de téléphoner pour être espionné. Partout sont perfectionnées et répandues des technologies dites sécuritaires qui font du citoyen un être perpétuellement surveillé, ou pouvant l’être à tout moment. Et jamais la population carcérale ou soumise à un contrôle judiciaire n’a été aussi élevée24. Ce qui est peut-être le plus terrible, c’est que l’extrême désordre, l’extrême dégradation et désagrégation de la société qu’engendre le capitalisme sénile contemporain, font qu’ils engendrent aussi le besoin sécuritaire chez les individus, plus prompts en général à lutter contre les effets que contre les causes. Besoin que le pouvoir médiatique excite en permanence par des campagnes faites pour susciter la peur, l’hostilité vis-à-vis des autres plutôt que contre le capital. Besoin que l’État, pompier pyromane, s’empresse d’essayer de satisfaire puisque cela renforce son pouvoir, celui du capital, sur la population. « Nous acceptons de vivre dans une société pénitentiaire parce que le contraire semble beaucoup plus dangereux »25. Et on accepte aussi que le prétexte sécuritaire serve à justifier maintes expéditions militaires néocoloniales : il suffit de les baptiser d’opérations contre des terroristes. De sorte, finalement, que le besoin sécuritaire engendré par l’insécurité grandissante d’un système capitaliste à bout de souffle amène, paradoxalement, à faire adhérer, ou du moins à faire accepter passivement, une grande partie de la population à cet aspect important de l’évolution totalitaire de l’État qui a pour fonction de perpétuer ce système.
Arrêtons là la déjà longue liste des faits qui attestent de l’évolution de la domination du capital sous des formes de plus en plus totalitaires : elle crève les yeux, tellement que beaucoup ne la voient pas.
Pour autant elle n’est pas achevée. La crise économique actuelle exige pour que se maintienne le système capitaliste, nous l’avons rappelé, un accroissement de l’extraction de la pl sous sa forme absolue, donc aussi une aggravation de la domination du capital sur les prolétaires sous des formes beaucoup plus brutales. Ce qui est l’affaire de l’État. La paupérisation des masses et le chômage ne peuvent que s’accroître. Ce qui génère une crise politique, qui menace, non pas nécessairement le capitalisme (pour cela il ne faudrait pas seulement une crise, mais une révolution politique), mais à tout le moins le personnel politique dirigeant l’État, qui amène à modifier le mode de gouvernement de l’État, sa façon de dominer la société et d’organiser la reproduction du capital.
C’est que le peuple est toujours poussé à exiger de l’État d’être ce que l’idéologie et la propagande bourgeoises lui ont fait croire qu’il est : défenseur de l’intérêt général, garant de son existence, de la croissance, de l’emploi, de la juste répartition des richesses. Cette exigence s’exacerbe avec la crise, les peurs qu’elle engendre, un présent qui se fait de plus en plus difficile, et l’avenir pire encore. Constatant que l’État est incapable de remplir ce qu’il croît être son rôle, mais croyant (en vertu des fétichismes dont nous avons parlé) qu’il le pourrait s’il était bien dirigé, le peuple est alors plus ou moins séduit par les sirènes « populistes », à l’illusion du « coup de balai », du « qu’ils s’en aillent tous » et qu’on en mette d’autres à la place des élites politiques traditionnelles qui s’avèrent effectivement aussi inefficaces à satisfaire ses besoins que corrompues et promptes à satisfaire aux exigences brutales de la valorisation du capital, à protéger les spéculateurs et à favoriser l’enrichissement exorbitant d’une mince couche de dirigeants. Ces « populistes » affirment qu’ils sauront, eux, tenir en laisse le capital et le mettre au service du peuple en sachant diriger l’État comme l’idéologie bourgeoise dit qu’il devrait l’être.
Entre la haute bourgeoisie et les « populistes » il y a là les prémices d’une crise politique, qui, en termes de classes, s’analyse comme un affaiblissement de la direction de la haute bourgeoisie sur son alliance avec les couches moyennes et populaires qui était jusqu’à présent l’assise de l’État démocratique bourgeois. Or, pour la bourgeoisie, il est évidemment plus avantageux et plus sûr d’occuper elle-même l’État. Plus avantageux : elle peut y caser à des postes lucratifs des dizaines de milliers de ses membres. Plus sûr : qui mieux qu’elle peut diriger le capitalisme dont elle connaît tous les rouages ? Voilà longtemps qu’elle a décidé de se réserver l’accès aux études supérieures, qu’elle s’est éduquée aux meilleures façons de valoriser le capital, qu’elle en confie la direction à l’élite qui s’en dégage. Sélectionner une telle élite, lui confier le pouvoir, ne peut être le fait du peuple ignare, influençable par toutes les démagogies ou toutes les utopies. C’est une vieille antienne. Voltaire et ses collègues pensaient déjà que le peuple ne pouvait qu’être dirigé par des despotes éclairés par eux, les Lumières. Et Sieyès, qui avait un temps affirmé que le Tiers État devait être tout, confirmait cette opinion très largement partagée dans les rangs de la bourgeoise républicaine en affirmant que le peuple n’a « ni assez d’instruction, ni assez de loisirs » pour gouverner.
Bien sûr la vérité que tentent de masquer ces arguments est que, si le peuple n’est, certes, pas le mieux qualifié pour organiser la valorisation du capital et la répartition des richesses qui découlent des rapports de propriété capitalistes, ni pour garantir ceux-ci, il peut l’être pour se révolter contre ce système. C’est donc surtout pour empêcher toute opinion révolutionnaire de se faire connaître et de prospérer, pour étouffer le développement d’une critique radicale et pratique du capitalisme que la bourgeoisie proclame que, puisqu’il n’est pas capable de bien diriger la reproduction de la société capitaliste, c’est qu’il est incapable d’en diriger aucune. Les « populistes » l’embarrassent aujourd’hui parce qu’ils sèment la zizanie dans le camp du capital, qu’ils prétendent diriger l’État à sa place, et que leurs projets aggraveront plus encore la crise. Mais elle les tolère, ne les réprime pas, parce qu’ils sont des partisans de la reproduction du capital, de sa croissance, ce qui peut malgré tout lui être bien utile dans la mesure où ils influencent une partie du peuple dans ce sens, et en faveur d’un État capitaliste renforcé : ils sont donc quand même pour elle une éventualité bien plus favorable que celle d’une révolution politique qui détruirait cet État afin d’abolir les classes.
Pour compléter ce bref exposé de l’évolution historique du MPC vers le totalitarisme, il convient d’observer que ce que l’idéologie bourgeoise nomme ainsi – et dont les analyses de Hannah Arendt sont la référence – est loin de rendre compte de cette réalité dans toute son ampleur, telle qu’elle vient d’être brièvement montrée. En résumé, elle oppose comme antagoniques État bourgeois démocratique et État bourgeois fasciste. Elle en reste ainsi à opposer différentes formes de cet État, telles que séparation (ou pas) des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires (« État de droit »), pluralité (ou pas) des partis politiques, liberté (ou pas) d’expression, etc. Or, non seulement ces différentes formes ne sont que différentes modalités d’exercice de la dictature bourgeoise, de la domination absolue du capital, mais leurs différences tendent toutes, dans le capitalisme moderne, à s’effacer. En effet, même dans les régimes se prétendant démocratiques, l’État s’hypertrophie en une immense bureaucratie vidée de tout contenu démocratique, dont les différents appareils, qui se concurrencent pour obtenir le plus de moyens et d’influence, sont néanmoins interdépendants et non pas séparés, et se posent tous ensemble comme un pouvoir totalitaire (au sens où ce terme a été défini ci-dessus) sur les « citoyens ». De sorte que le fascisme sera peut-être encore, comme il l’a déjà été, plus une prolongation – y compris en termes de massacres de masse26 – qu’une rupture avec cette tendance historique au totalitarisme. On sait d’ailleurs que la quasi-totalité des hauts dirigeants fascistes (et bien sûr la masse des dirigeants intermédiaires et inférieurs) poursuivirent tranquillement leurs carrières après 1945. Les historiens en ont souvent rendu compte, comme encore récemment l’Allemand Michael Wolffsohn reconnaissant que : « L’Allemagne d’après-guerre a été marquée par une continuité dans le personnel politique et judiciaire et dans l’appareil policier […] Le véritable miracle (sic !) de la République fédérale, c’est d’avoir construit une démocratie avec le même personnel politique que sous le nazisme »27. En France aussi. Le collaborateur de Pétain (puis ministre brutal partisan de l’Algérie colonisée), François Mitterrand, en a même été le président socialiste.
Ainsi Hannah Arendt ne voit pas que le totalitarisme ne se limite pas à une forme d’État, le fascisme, mais définit une dépossession totale des individus dans tous les domaines de leur vie, dans tous les rapports sociaux, qu’ils soient ceux de l’infrastructure ou de la superstructure, pour reprendre le vocabulaire de Marx. Elle ne voit pas que c’est une tendance nécessaire du capitalisme, nécessaire à la reproduction du capital, à l’évolution historique des conditions de cette valorisation28. Elle ne voit donc pas non plus que les États contemporains dits démocratiques sont aussi, à leur façon, des États totalitaires, parce que c’est l’ensemble du système capitaliste moderne qui l’est.
Certes, certains idéologues proches des thèses de Hannah Arendt ont plus particulièrement insisté sur les bases matérielles du totalitarisme, établissant un lien entre le développement du machinisme et celui de l’aliénation-abrutissement des masses doublé d’une technocratisation-bureaucratisation de l’État se faisant tentaculaire et totalitaire. Mais ils ne voient la cause de ces phénomènes que dans le développement des sciences et des techniques appliquées à la production, qui rendrait impossible selon eux que les individus les maîtrisent, soient possesseurs des conditions organiques de leur vie (du coup certains en tirent la conclusion que seul un retour à la petite production et à l’artisanat permettrait cette maîtrise, cette possession !). Ils ne voient pas les caractères spécifiquement capitalistes de ce développement, notamment la division sociale du travail intellectuels/exécutants qui est, dans le capitalisme moderne, la manifestation la plus profonde et la mieux cachée des rapports d’appropriation-dépossession et de domination qui sont le capital. Ils ne voient pas, dans le développement du machinisme lui-même, les conditions qui permettent de briser ces rapports (notamment celle du temps libéré du travail contraint) en même temps que la subsomption des masses prolétaires sous le machinisme et sous l’État. Il serait donc impossible, selon eux, d’éviter une sorte de totalitarisme de type orwellien. Ce que les idéologues du fascisme (tel le philosophe nazi Heidegger, dont Hannah Arendt fut un temps très proche) ont théorisé à leur façon : puisque l’individu n’existe plus en tant qu’individu privé, qu’il n’est plus qu’un élément parmi d’autres d’une communauté nationale que seule une petite élite peut diriger, le mieux qu’il puisse faire pour satisfaire ses besoins est de se consacrer corps et âme à la rendre la plus puissante possible. Ce qui n’est qu’une totale aliénation à cette communauté et à ses chefs « qui savent », l’individu n’étant, lui, qu’un élément totalement subordonné, discipliné et aveugle.
Pour conclure, on voit que l’usage que font les idéologues bourgeois du mot totalitarisme en le limitant à la désignation de formes fascistes de l’État consiste : 1°) à masquer que c’est l’ensemble du système capitaliste qui est devenu totalitaire ; 2°) à prétendre que l’alternative aujourd’hui serait entre la forme fasciste du totalitarisme et sa forme démocratique, deux formes de l’État bourgeois ; 3°) à condamner par avance toute lutte révolutionnaire comme ne pouvant nécessairement que déboucher sur un État totalitaire puisqu’une telle lutte, par définition, détruit l’État bourgeois existant, qu’il se dise ou pas démocratique, ne se limite pas à l’antifascisme.

