LA DROITE EXTRÊME ET LA CRISE
Publié par admin on Mar 18, 2015 | 0 commentaire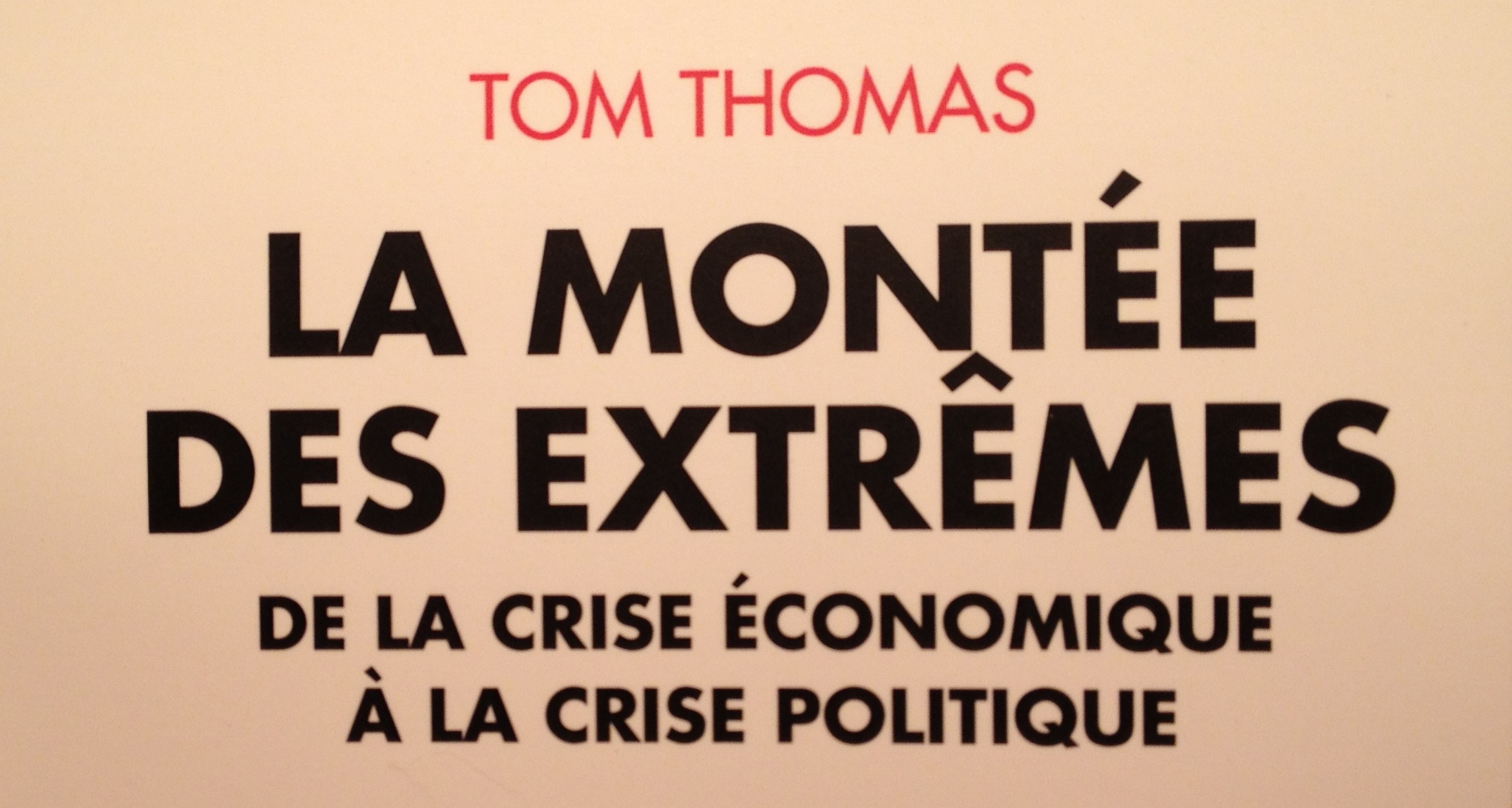
CHAPITRE 3 du livre de Tom Thomas « La montée des extrêmes »
Les fascismes des années 3029, en Allemagne comme en Italie, ne furent pas initialement une création de la bourgeoisie, qui y avait déjà écrasé les insurrections prolétaires d’après-guerre, mais essentiellement un surgissement « d’en bas »30, une manifestation de l’enragement d’une masse hétéroclite d’individus, causé par la crise et accentué par le sentiment d’avoir été injustement désavantagés et maltraités par les traités d’après-guerre.
Un surgissement du même type se développe aujourd’hui. Il n’est pas difficile à constater. Sociologues et autres observateurs des mouvements sociaux reconnaissent aisément que la montée d’une sorte de néofascisme est une conséquence de la crise qui fait dégringoler l’échelle sociale à des millions d’individus, et jusqu’au niveau du trottoir, et même en dessous, suscitant peurs, angoisses et rage à l’encontre de groupes que leur bon sens borné (populiste !), attisé par quelques habiles démagogues, leur désigne comme responsables : les politiciens pourris, les étrangers, les rouges fauteurs de troubles.
Comme ils ne voient pas les causes de cette crise, ils ne peuvent évidemment rien proposer qui la résoudrait et supprimerait ainsi cette dégringolade. Ils se limitent à constater la coïncidence, certes bien réelle, entre une crise profonde du capitalisme développé et la montée d’une idéologie fascisante et des comportements qui en découlent. Ils n’expliquent pas non plus pourquoi ladite crise engendre précisément cette idéologie. Ils ne le peuvent pas parce que ce serait remettre en cause l’idéologie de l’État et de la Nation qu’ils ont eux-mêmes répandue, et continuent à répandre.
En effet, l’idéologie fasciste est une manifestation exacerbée des fétichismes de l’État, de la Nation et de la marchandise générés par les rapports sociaux de propriété qui définissent le capitalisme. Lesquels fétichismes et rapports ont été abondamment propagés et justifiés depuis quelque trois siècles par les idéologues bourgeois. On sait31 que dans ces fétichismes la Nation est une communauté d’individus s’associant volontairement par le moyen de l’État. Alors qu’elle n’est qu’une communauté imaginée32, puisqu’y règnent en réalité les divisions des intérêts privés concurrents et les antagonismes de classes. Tellement imaginaire d’ailleurs – mais l’imaginaire suscite néanmoins des comportements – qu’elle n’a d’existence concrète que comme État, un organe extérieur à ces individus, qui ne les unit que parce qu’il les domine et les contraint, et comme patriotisme, c’est-à-dire l’enrôlement des individus dominés dans la lutte et la guerre contre d’autres, au profit des seuls dominants33, que l’État organise et impose. On a vu que, dans le fétichisme de l’État, celui-ci doit et peut assurer le bien-être du peuple qu’il domine. Dans le fétichisme de la Nation, cela veut dire qu’il fait croître sa puissance, en réalité celle du capital dit national.
Et cela veut dire développement de l’impérialisme, de la course aux approvisionnements, aux débouchés, à l’expansion de l’aire de la valorisation du capital en même temps qu’augmente aussi sa concentration : la domination du capital se fait totalitaire, et sous des formes particulièrement meurtrières, à l’échelle mondiale.
Bref, le fascisme n’invente rien, il pousse à bout, exacerbe au plus haut point, les tendances totalitaires inhérentes à l’accumulation du capital. Ce « surgissement d’en bas » d’une masse hétérogène de mécontents enragés et imbibés de ces fétichismes qui fondent l’idéologie et les comportements bourgeois advient quand, apeurés, paniqués par les effets sur eux d’une crise du capitalisme moderne, ils constatent que l’État ne joue pas le rôle que cette idéologie leur fait croire devoir et pouvoir être le sien : représenter leur puissance, assurer les conditions de leur existence34. Ceux-là ne disent pas : l’État n’est pas ce que je pensais qu’il était, mais : s’il est impuissant à me servir, s’il m’abandonne au lieu de me faire vivre, c’est qu’il est mal gouverné.
Alors c’est la crise politique, le rejet de l’élite bourgeoise traditionnelle, avec son alternance droite-gauche qui ne change jamais rien au système et à ses tares. On exige le grand « coup de balai », que s’en aillent de la tête de l’État tous ces gens incapables de redresser la situation, mais si capables de se servir de l’État pour s’enrichir, eux, leurs familles, leurs amis, leurs clientèles. Ce ramassis de mécontents enragés, pleins de peurs (de la crise, des immigrés, des voleurs, des révolutionnaires, des homosexuels…), s’imaginent que c’est simplement parce que l’État est aux mains de politiciens immoraux et corrompus, ne défendant que leurs intérêts et ceux de la finance, mondialisée et donc apatride (cosmopolite disait-on dans les années 30), bradant l’intérêt national à la bureaucratie européenne – et tout cela sont des évidences bien visibles – qu’il ne les représente pas, ne résout pas leurs problèmes, ne s’y intéresse même pas : les abandonne (le « sentiment d’abandon » comme disent les sociologues est évidemment l’apanage de ceux qui attendent tout de l’État).
La solution serait donc ce grand « coup de balai » qui permettrait de confier l’État à de bons chefs, probes, déterminés à nettoyer les écuries d’Augias, cette pétaudière politicienne, aptes à représenter vraiment le « tous », la Nation, de renforcer son unité pour qu’elle défende ses intérêts dans ce monde rempli de concurrents (toujours déloyaux par définition), de financiers cosmopolites, d’étrangers envahissants, coucous voulant prendre votre place et profiter de vos « acquis sociaux », d’ennemis complotant votre perte.
On peut d’ailleurs observer que, plus dans la réalité la société civile se divise et se désagrège – ce qui est évidemment le cas en période de crise où se développe d’abord le sauve-qui-peut individuel et où s’exacerbent les antagonismes, y compris au sein de l’élite bourgeoise dominante (par exemple : libéraux/étatistes néokeynésiens, pro et anti-européens) –, et plus l’unité ne réside que dans l’imaginaire de la Nation et de son bras armé, l’État. Ce que les idéologues néofascistes s’efforcent de renforcer.
Ils proclament sur tous les tons qu’eux sauront restaurer la puissance de la Nation, en la sortant des griffes des financiers, des capitalistes mondialisés adeptes des délocalisations, des envahisseurs immigrés, et en soutenant parallèlement les « bons capitalistes », ceux qui accepteraient d’investir vertueusement pour et dans la patrie. Ceux-là seront aussi protégés de la concurrence, qui ne peut être que déloyale, des concurrents étrangers par un protectionnisme renforcé. Tout opposant à cette soi-disant restauration sera évidemment stigmatisé, voire condamné et puni, comme antipatriote, déserteur, agent de l’étranger. Ainsi on aurait l’union pour le bien commun au lieu de la dispute pour les postes ; l’ordre et l’efficacité au lieu de la gabegie ; l’honnêteté au lieu des turpitudes ; la volonté au lieu de l’abandon, et, récompense finale, la puissance au lieu de l’impuissance, la victoire au lieu des défaites35.
L’expérience historique devrait avoir assez prouvé combien est illusoire et catastrophique ce type d’idéologie, qui prétend, par des moyens aussi simplistes que brutaux, créer une troisième voie « ni communiste, ni capitaliste, mais nationale et rationnelle ». Néanmoins la croissance de partis néofascistes dans toute l’Europe manifeste qu’il n’en est rien. Par exemple en France, alors que le FN sous la direction de Le Pen père n’était qu’un parti d’extrême droite, ultranationaliste et xénophobe, mais prônant paradoxalement un capitalisme « libéral » de type reaganien ou thatchérien, il se fascise avec Le Pen fille, c’est-à-dire cherche à conquérir une base populaire élargie (manœuvre que les médias qualifient de « dédiabolisation » alors qu’elle est encore plus diabolique). Il continue à stigmatiser les immigrés, mais au nom de la défense de la laïcité, ce qui fait plus progressiste. Il présente son ultranationalisme comme le moyen du progrès social et une critique des gros capitalistes mondialisés. Il évoque une éventuelle nationalisation des entreprises « stratégiques » pour les sortir des griffes des financiers apatrides. Il parle de moduler le taux de l’impôt sur les sociétés suivant la destination des bénéfices : élevé s’ils sont distribués aux actionnaires, plus faible s’ils sont affectés aux salariés et à l’investissement sur le territoire national. Il propose de fusionner la CSG avec l’impôt sur le revenu afin de la rendre proportionnelle à ceux-ci. Il présente le renforcement du protectionnisme comme une lutte progressiste contre « le dumping social et écologique » des concurrents étrangers, et la sortie de l’Europe (qui, un comble, serait selon lui allemande, le vieil ennemi) comme la restauration du pouvoir du peuple contre la bureaucratie antidémocratique bruxelloise. Il dénonce bruyamment l’impuissance et la corruption des politiciens de « l’UMPS » se partageant le gâteau de l’État en alternance.
Tout cela forme un discours populaire (qui, nous le verrons, se présente sur bien des points comme proche de celui du FG). C’est un discours semblable qu’utilisaient les fascistes allemands et italiens, avant de tourner casaque une fois au pouvoir. Pas seulement parce qu’ils ne reculaient devant aucun mensonge, aucune promesse, pour arriver au pouvoir, mais parce qu’il était contradictoire, impossible de prétendre développer un capitalisme qui soit bon pour le peuple. Et qui plus est irrationnel de prétendre le faire par des moyens bridant la croissance et la puissance du capital, alors même que celles-ci sont affirmées comme le moyen de ce but.
Or ce type de programme est aujourd’hui encore plus irrationnel, si l’on peut dire, du fait d’une situation bien différente du capitalisme. Pour ne prendre qu’un exemple, organiser un capitalisme purement français en sortant de l’Europe, et, au-delà, du marché mondialisé, à l’époque où l’aire de valorisation du capital est nécessairement mondiale, où les entreprises situées en France ne sont que des maillons, étroitement spécialisés, d’une chaîne de valorisation mondiale, où 1/3 environ de la consommation provient nécessairement de l’extérieur, conduirait à une aggravation considérable de la crise et de la misère des masses. Ainsi Mme Le Pen prévoit elle-même que le seul retour au franc entraînerait une dévaluation de 25 % (un minimum en fait !) par rapport à l’euro, et donc une hausse de 25 % des prix des produits devant être importés (ce qui constituerait une facture d’environ 672 milliards d’euros, 1/3 du PIB, dont 46 milliards rien que pour l’énergie). Les exportations, censées être favorisées par cette dévaluation, ne combleraient pas ce trou puisqu’elles seraient au contraire freinées par des mesures protectionnistes de rétorsion. Le capital financier imposerait toujours sa force en faisant exploser les taux d’intérêts de la dette maintenant libellée en franc, devenu pour lui une monnaie de singe. Le service de cette immense dette deviendrait alors un fardeau encore bien plus insoutenable qu’aujourd’hui, d’où de violents conflits de tous ordres, internes s’il était question de le faire supporter par le peuple, et externes, l’ultranationalisme poussant toujours face aux problèmes à affronter l’étranger.
Certes le fascisme n’est pas du côté du rationnel, mais de celui des fétichismes les plus exacerbés. Son discours peut donc séduire, quels que soient les arguments qu’on peut lui opposer. D’autant plus que seules les élites intellectuelles bourgeoises ont accès aux médias de masse, or leurs propres arguments « républicains » font immédiatement long feu puisqu’elles sont, à juste titre, largement discréditées comme responsables de la crise et incapables d’y mettre fin. Arguments qui, d’ailleurs, ne peuvent guère être efficaces puisqu’ils ne peuvent pas porter sur la critique de ces fétichismes, que ces élites partagent et se sont efforcées de répandre. Ainsi, même si le capital, aujourd’hui mondialisé, a encore beaucoup moins intérêt au fascisme qu’il y a un siècle, même s’il ne contribuera pas dans la même mesure qu’alors à porter Mme Le Pen au pouvoir, même si, plus qu’alors, « la bourgeoisie ne peut que craindre la stupidité des masses tant qu’elles restent conservatrices, et leur intelligence dès qu’elles deviennent révolutionnaires »36, il n’en reste pas moins très possible une évolution du totalitarisme d’apparence démocratique vers une forme exacerbée, un totalitarisme de type fasciste.
Combattre ce totalitarisme ne peut pas se faire au nom de ce dont il n’est que le prolongement. Il faut aller jusqu’à sa racine (être radical), en comprenant qu’il est un résultat de l’évolution du mode de production capitaliste, et donc que cette racine ce sont les rapports sociaux d’appropriation qui fondent ce mode de production capitaliste.

