CRISE POLITIQUE OU RÉVOLUTION POLITIQUE : RENFORCER OU ABOLIR L’ÉTAT BOURGEOIS ?
Publié par admin on Août 3, 2015 | 0 commentaire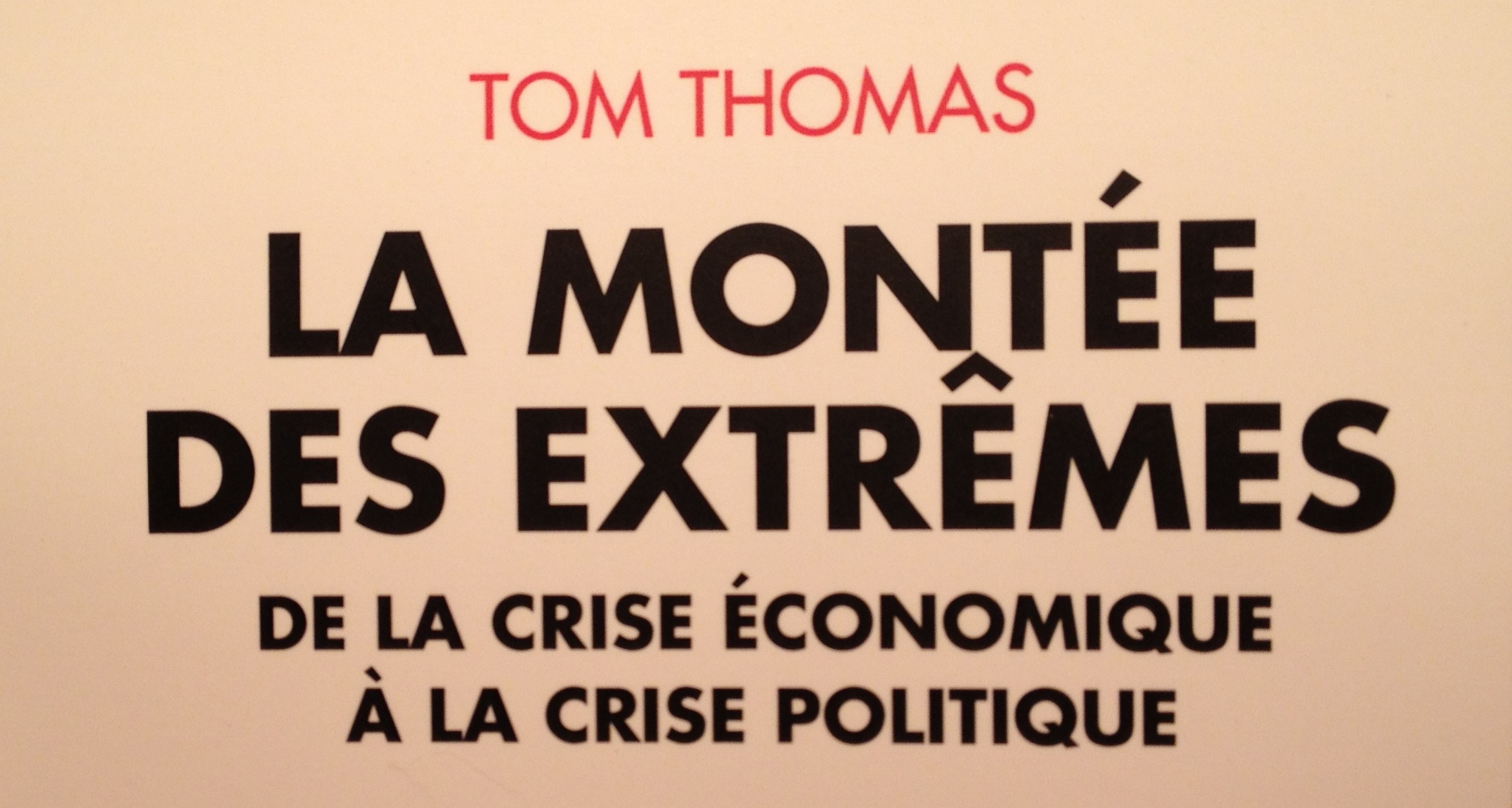
CHAPITRE 5 du livre de Tom Thomas « La montée des extrêmes »
En France, comme ailleurs en Europe, il est assez probable que, la situation du peuple s’aggravant, les forces politiques traditionnelles de l’alternance droite-gauche, qui, depuis longtemps, ne constituent plus une alternative, soient déconsidérées au point d’avoir à céder la place à l’une de ces forces qu’elles qualifient de « populistes », « protestataires », « extrémistes ». Ce qui serait la manifestation d’une modification de la domination qu’exerce la grande bourgeoisie dans son alliance de classe traditionnelle avec les « couches moyennes » et une partie du prolétariat. Alliance qu’organise cahin-caha le système d’État dit démocratique puisqu’elle est une condition de son existence sous cette forme qui a l’avantage de faire croire que cet État est l’exécuteur de la volonté populaire.
Nous avons vu qu’aucune de ces forces dites « populistes » ne s’attaquait sérieusement au capital, mais seulement à quelques-uns des effets qui lui sont inhérents, à quelques capitalistes « trop » avides et mondialistes. Bref, qu’elles n’étaient pas radicales (ne s’attaquaient pas aux racines de ces effets), mais seulement extrémistes, c’est-à-dire poussant à l’extrême les tendances totalitaires inhérentes au MPC.
Nous avons vu également que le couple fétichisme de la marchandise-fétichisme de l’État leur était un fondement idéologique commun44. Il y a d’ailleurs dans ces fétichismes complémentaires comme une logique implacable : plus l’État s’avère impuissant à résoudre la crise, à guérir les tares sociales, à soulager le peuple des maux qui l’accablent, et plus ils poussent ce peuple à penser que c’est parce que cet État n’est pas encore assez puissant, pas assez tentaculaire, n’a pas assez de moyens, et qu’il faut donc étatiser encore plus la société. De même, plus les individus ont été dépouillés de la propriété des conditions de leurs vies, et plus ils ont d’abord tendance à placer tous leurs espoirs dans l’État, comme autrefois (et même encore aujourd’hui) dans la religion, attendant de lui réconfort, sollicitude, et mieux-être. Ainsi, plus l’État s’occupe de tout, plus il est totalitaire, et plus il leur semble indispensable, plus ils lui réclament. De sorte que le capitalisme en crise suscite inéluctablement une poussée d’étatisme dans les masses, en même temps qu’un mécontentement croissant vis-à-vis de l’impuissance, des échecs de l’État. Son impuissance à sortir de la crise est bien réelle, mais elle apparaît comme celle des seuls dirigeants politiques de l’État. Laquelle est bien réelle aussi, et bien visible malgré la multitude de « communicants » qui les entourent, eux qui, faute de mieux, passent leur temps à « communiquer », c’est-à-dire à essayer de faire croire qu’ils agissent efficacement pour le bien du peuple. Impuissance qu’exploitent les extrémistes propagandistes du « coup de balai » qui, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, s’avéreront vite tout aussi impuissants que leurs prédécesseurs à la tête de l’État. Mais en tant qu’extrémistes d’un système social en putréfaction, ils le seront aussi dans les désastres qu’ils provoqueront.
La seule possibilité aujourd’hui de sortir de la crise du capitalisme étant de sortir du capitalisme, c’est évidemment tout autre chose que de changer quelques-uns des individus qui gèrent l’État et les entreprises. Quand le Titanic coule, bien que réputé aussi insubmersible que le capitalisme, ce n’est pas changer les officiers qui sauvera les passagers. D’ailleurs les néofascistes ne proposent pas de les changer vraiment, mais qu’ils soient patriotes. Le FG propose lui une sorte de capitalisme d’État qu’il présente comme un capitalisme sans capitalistes, ou à tout le moins si fortement tenus en laisse et taxés par l’État que ce serait tout comme. En fait le capitaliste serait l’État, ou des dirigeants prétendant ne pas être des capitalistes, ou si peu, si modérément, si soucieux du bien général ! Ainsi le rapport de domination, et donc d’appropriation, capitaliste subsisterait, mais, miracle, sans ses conséquences. Déjà en son temps Marx se moquait durement de ces vieilles tartarinades : « Bien sûr certains socialistes disent : nous avons besoin du capital, mais non du capitaliste. Le capital apparaît alors comme pure chose (toujours le fétichisme de la marchandise) […] Certes je peux séparer le capital de tel capitaliste singulier […] (mais) non du capitaliste qui en tant que tel fait face au travailleur »45. Lequel capitaliste, aujourd’hui collectif dans la propriété financière comme dans le management, est le maître des conditions de la production, que l’entreprise soit privée ou étatisée46.
Cette différence dans la façon de présenter leurs projets amène à remarquer que les bases idéologiques communes entre les deux courants partisans du grand « coup de balai » qui ferait devenir l’un ou l’autre « calife à la place du calife » ne doit pas conduire à les considérer comme identiques en tous points. Le courant type FG se présente comme formellement anticapitaliste, tandis que le courant type FN affiche d’abord, et surtout, un nationalisme exacerbé jusqu’à la xénophobie et au racisme, et ne peut cacher, malgré ses efforts, son néofascisme. De sorte que cela amène à distinguer les individus qui les soutiennent. Ils ne partagent pas systématiquement les mêmes motivations, les mêmes pratiques, les mêmes buts, quand bien même ils se trompent tous, à leur façon, sur les moyens de les atteindre. Les uns sont les héritiers du « vieux mouvement ouvrier » social-démocrate, les autres des antidreyfusards, des ultraréactionnaires de toujours, des fascismes.
Mais cette distinction n’a d’utilité que dans la perspective de la construction d’une force organisée en vue de mener à terme le processus d’une réelle abolition des rapports d’appropriation capitalistes. Force qui ne sera suffisante que si nombre des individus qui adhèrent aujourd’hui, plus ou moins, aux propositions du type de celles du FG, et beaucoup d’autres encore, y participent activement. Mais, évidemment, ils ne le pourront que dans la mesure où ils seront amenés par les circonstances, les expériences, la réflexion et ses besoins de théorie, à abandonner l’idée d’une continuation de la société capitaliste par les moyens traditionnels du « vieux mouvement ouvrier » réformiste, imbibé de socialisme vulgaire. Mouvement dont le but était limité à l’amélioration graduelle des conditions de vie matérielle des ouvriers des métropoles impérialistes : hausse des salaires directs et indirects, congés payés, retraites, sécurité sociale, etc., jamais rien qui remette en cause le rapport bourgeoisie/ouvriers. Au contraire, le rapport de domination du capital était sans cesse accentué (notamment par l’accroissement de la division capitaliste du travail entre les maîtres des conditions de la production et les ouvriers) ainsi que le taux d’exploitation47 (notamment par les hausses de productivité). Et dans ce rapport salarial ainsi perpétué et aggravé, il est vrai qu’une plus grande puissance du capital qui emploie le prolétaire est un facteur qui contribue à augmenter les miettes que, sous la pression de luttes grévistes, le capital est amené à lui distribuer. Puissance du capital voulant dire alors capacité à augmenter l’extraction de la pl sous sa forme relative dans les métropoles, à dominer les concurrents et à exploiter à outrance les peuples colonisés (puissance impérialiste que le vieux mouvement ouvrier n’a jamais vraiment contestée, au contraire il l’a bien souvent plus ou moins ouvertement approuvée). D’où le soutien constant des socialistes vulgaires à la croissance du capital les employant, rejoignant le chœur tonitruant des patrons clamant : il ne faut pas tuer l’entreprise qui vous nourrit, mieux vaut l’engraisser.
Certes, ce vieux mouvement ouvrier a obtenu, dans les métropoles impérialistes, des résultats notables en ce qui concerne l’amélioration du niveau de vie matériel, mais au prix de l’aliénation croissante, de la dépossession croissante des prolétaires par le capital48. Observons aussi que ses succès matériels ont renforcé l’influence sur lui de l’idéologie bourgeoise, et des organisations du socialisme vulgaire (dénommées « la gauche ») qui l’y cultivait. Au point qu’elles ont pu longtemps le dominer largement, et en conséquence le diriger vers de graves défaites en y étouffant le moindre embryon révolutionnaire (par exemple, le PCF organisant la soumission de la Résistance à la bourgeoisie contre quelques postes de ministres), ou même seulement dès que la lutte prolétaire menaçait d’échapper à son emprise et de gêner un peu sérieusement le capital (cf. 1936, 1947, 1968 en France). Et si on ajoute à ce rapide tableau du prix payé par les masses populaires en échange de l’élévation de leur niveau de vie matériel les immenses souffrances et destructions des deux guerres mondiales et des guerres coloniales, on peut à juste titre conclure qu’elles ont eu bien plus à perdre qu’à gagner à borner l’horizon de leurs luttes au réformisme, c’est-à-dire, au fond, à un soutien, aussi revendicatif fût-il, à la croissance du capital.
Mais l’histoire passée n’est pas notre propos, bien qu’elle puisse apprendre beaucoup. Admettons même, pour faire court, que les circonstances de l’époque déterminaient cette orientation qu’a prise, majoritairement, le mouvement ouvrier d’alors (nous reviendrons sur ce point plus loin), et donc ses limites. Le fait nouveau est qu’aujourd’hui cette orientation est une impasse totale : elle ne peut même pas aboutir, comme autrefois, à l’obtention d’avantages matériels (sauf exceptions locales et momentanées), puisque la dégradation drastique du niveau de vie des travailleurs est devenue, comme nous l’avons rappelé précédemment, une nécessité absolue de la reproduction du capital et de la survie du capitalisme dans un état de crise chronique. Au mieux, les luttes sur les thèmes traditionnels du vieux mouvement ouvrier sont, et ne seront, que des luttes défensives qui permettront d’atténuer, plus ou moins suivant leur force, cette dégradation, d’obtenir, pour un moment, moins pire que pire, c’est-à-dire de retarder quelque peu le pire.
Il résulte de ces faits une conclusion quant à la crise politique qui se dessine déjà aujourd’hui. En effet la question d’un autre pouvoir politique que celui, usé et déconsidéré, de l’alternance droite-gauche apparaît, et apparaîtra inéluctablement de plus en plus aux masses, comme le moyen le plus immédiat, et le plus fondamental pour sortir de la crise. Mais de deux choses l’une : soit elle se développe dans les limites étroites d’un simple changement des dirigeants traditionnels de l’État bourgeois, comme le proposent les extrémistes de droite et de gauche (FN et FG en France), et il ne s’agira de rien d’autre que d’un prolongement extrême du totalitarisme étatique-bureaucratique inhérent au capitalisme sénile, et de ses tares sociales catastrophiques ; soit elle se développe comme construction d’un nouveau mouvement prolétaire49. Un mouvement qui, bien au-delà du simple « coup de balai », se forge comme moyen d’une lutte pour détruire ce totalitarisme, à commencer par cet État qui l’incarne et l’organise au premier chef. C’est le seul changement politique qui puisse permettre de sortir de la crise en engageant le processus de sortie du capitalisme qui en est la condition.
Ainsi l’alternative, dans la crise politique qui, mûrissant, tend à mettre au premier plan les « extrêmes », n’est pas entre celui de gauche et celui de droite (pas plus qu’elle n’était jusque-là entre libéralisme et étatisme50), mais entre, d’une part, ces deux courants étatistes se proposant, l’un comme l’autre, « d’améliorer » le capitalisme, et, d’autre part, la construction d’un nouveau mouvement communiste pour ouvrir le processus de son abolition. Car gauche de la gauche comme droite de la droite, le curseur est toujours sur la même ligne capitaliste.
Avant d’en résumer les grandes lignes, observons que, si le danger que représente l’extrémisme type FN, auquel s’agglutine déjà une bonne partie de la droite « classique » type UMP, apparaît aujourd’hui, à juste titre, le plus menaçant, cela ne doit pas pour autant amener à négliger la critique sans faiblesse de l’extrémisme de gauche, type FG, puisqu’une bonne part des idées qu’il propage a pour effet de légitimer et populariser aussi beaucoup de celles de l’extrémisme de droite dont elles ne diffèrent souvent guère sur le fond. Taire ou édulcorer cette critique pour faire cause commune avec certains partis « de gauche » défenseurs du MPC au nom de la lutte contre le totalitarisme d’extrême droite, ce serait d’ailleurs reprendre l’usage que les idéologues bourgeois font de ce terme en le limitant à la désignation de formes fascistes de l’État (cf. fin chapitre 2).
Revenons à ce terme de l’alternative posée ci-dessus : le processus d’abolition du capital. Il est un processus d’appropriation par les individus s’associant des conditions matérielles, intellectuelles, sociales de la construction de leurs vies. S’approprier n’est une question juridique, l’effet d’une loi de l’État, que dans l’idéologie bourgeoise. En réalité c’est avant tout une activité pour s’approprier ces conditions. C’est donc bien un processus, plus ou moins long, puisqu’il s’agit, notamment, de s’approprier les conditions intellectuelles de cette construction afin d’en finir avec la domination des moyens de la production et de leurs possesseurs sur les producteurs, d’en finir donc avec la division du travail constitutive du rapport social qu’est le capital, et par là avec celle des classes et la nécessité de l’État comme puissance politique extérieure aux individus, les dominant.
Il arrive souvent d’entendre des idéologues affirmer que les communistes nagent dans une contradiction insurmontable puisqu’ils disent à la fois que les prolétaires sont aliénés, dépossédés des moyens intellectuels de la production, et qu’ils pourraient cependant en devenir les maîtres. Selon eux, seule une élite scientifique d’individus particulièrement doués pourrait le faire tant la chose est complexe, tant le contenu scientifique des moyens de production modernes échappe à la compréhension des masses prolétaires. C’est qu’ils ne comprennent pas que le processus de la révolution communiste est justement celui de cette appropriation, donc de l’abolition de la condition de prolétaire, dont la possibilité est fondée notamment sur l’extraordinaire potentiel de temps libre (de temps libéré de l’astreinte du travail contraint, aliéné, répulsif : prolétaire) qui gît dans les entrailles du capitalisme (et que lui-même ne peut s’empêcher de faire surgir à sa façon par un chômage croissant malgré la débauche d’emplois parasitaires, bureaucratiques, ou carrément fictifs qu’il génère). C’est un processus de transformation des besoins – qui peuvent devenir de plus en plus qualitatifs, d’enrichissement de qualités bien plus que de choses, dont la production de celles jugées nécessaires peut être assurée en peu de temps grâce à une productivité accrue et une participation de tous – ainsi que des activités, comportements et rapports entre les individus.
Il arrive aussi que des idéologues présentent l’avenir souhaitable, parfois même en prétendant qu’il s’agit du communisme, comme l’inversion des effets du capitalisme. Par exemple : une relative égalité des revenus au lieu d’une grande inégalité, parce que cela rendrait inoffensive les inégalités réelles dans la propriété des moyens de production des richesses ; une démocratie « horizontale » de pouvoirs locaux, supposée par ce seul fait comme « proches des gens », parce que ce serait une vraie démocratie (idée déjà présente chez Rousseau), alors qu’une démocratie « verticale » de pouvoirs centraux, géographiquement éloignés d’eux, serait la cause de l’État bureaucratique et totalitaire ; le retour aux « métiers » de la petite industrie, voire de l’artisanat, d’autrefois, parce que ce serait le seul moyen pour que les ouvriers puissent redevenir les possesseurs de leur outil de travail, au lieu qu’ils ne le pourraient pas de la machinerie sophistiquée de la grande industrie moderne (pensée présente chez Proudhon) ; la décroissance au lieu de la croissance, parce que ce serait le seul remède aux problèmes écologiques, la croissance ayant un effet immuable sur l’environnement, quel que soit le mode de production, et le capitalisme n’étant compris que comme « productivisme » et croissance à outrance. Bref, tout cela est vouloir le capital sans ses effets, est considérer que tous ceux-ci se réduisent à des problèmes de quantités dont il suffirait de modifier les rapports pour que la société devienne humaine, voire communiste, un avenir qui est alors conçu comme un simple retour au local, au petit, et n’aboutirait, si ce genre de rabougrissement était possible (ce qui n’est pas le cas), qu’à une société de pénuries, de domination du travail contraint, borné à une mono-activité misérable, faite d’échanges sociaux étriqués à tout point de vue, donc très peu enrichissants, bref, une société où le petit, le médiocre seraient décrétés en tout comme disait Marx51.
Le communisme n’est pas l’envers du capitalisme, car l’envers et l’endroit sont deux faces de la même chose. Il est construction d’un tout autre système de besoins, d’activités, de comportements, d’échanges, fondé sur des rapports sociaux d’appropriation des conditions de leurs vies par les individus et pouvant alors s’associer vraiment52. Il utilise certes « l’abondance » que le capitalisme a créée, mais comme un potentiel, car il la transforme de fond en comble puisque le capitalisme l’a créée comme abondance de marchandises en même temps que de pauvreté ; abondance de relations sociales en même temps que simples relations d’argent, qu’égoïsme, concurrence et rabougrissement dans l’avidité individuelle d’avoir des choses ; abondance de connaissances scientifiques en même temps que domination du profit, destruction de la nature et des hommes par leur usage et l’orientation de la recherche, étouffement des capacités scientifiques de milliards d’individus. L’abondance dans le communisme n’est pas de tout et n’importe quoi produit n’importe comment. C’est l’abondance de moyens pour des activités qualitativement supérieures et multiples (intellectuelles comme manuelles, artistiques comme scientifiques, sociales comme individuelles, ici comme ailleurs), libres car jouissives.
Par exemple, parmi cette abondance de moyens, citons l’existence d’un héritage considérable de connaissances scientifiques multiples, très développées, ainsi que de moyens de communications et d’échanges (d’enrichissements réciproques, de travaux menés en coopération, d’universalité) superbement efficaces, ou encore celui-ci qui est essentiel : l’abondance de temps libéré du travail contraint, répulsif, grâce au développement généralisé des sciences appliquées à la production (ce qui n’est pas justifier ce que le capitalisme produit, ni comment il produit, mais seulement l’efficacité avec laquelle il a rendu possible de produire), et à la suppression, immédiatement possible après une révolution politique, d’une myriade d’activités inutiles aux besoins populaires (dans le luxe, la finance, la publicité, les diverses bureaucraties, etc.), ou qui seront progressivement rendues inutiles (l’automobile individuelle, l’armement, les gaspillages innombrables propres à l’urbanisme capitaliste, etc.)53.
Certes tous les individus (bourgeois compris) sont déterminés et aliénés par le capital. C’est tout ce que les hommes ont créé au cours des siècles, qui se pose face à eux comme les déterminant et les aliénant, comme capital. Pour les prolétaires, qui, contrairement aux bourgeois, souffrent de cette situation et se rebellent, ce n’est certes pas en rêvant de retourner aux époques antérieures, où évidemment ils n’étaient pas ainsi dominés par ce qui n’existait pas, par ce qu’ils n’avaient pas encore créé, qu’ils y échapperont. Mais en se saisissant de ce qu’ils ont créé pour en faire le moyen de leur propre puissance, de leur abolition en tant que prolétaires. « À des stades antérieurs de développement, l’individu singulier apparaît plus complet parce qu’il n’a pas encore élaboré la plénitude de ses relations et n’a pas encore fait face à celles-ci en tant que pouvoirs sociaux indépendants de lui. Il est aussi ridicule d’avoir la nostalgie de cette plénitude originelle que de croire qu’il faille en rester à cette totale vacuité »54.
Par quoi peuvent-ils engager ce processus d’abolition du capital, de leur propre abolition en tant que prolétaires ? Autrement dit de quelle propriété, c’est-à-dire de quelle puissance peuvent d’abord se doter les individus sans propriété ? Avant de pouvoir démolir les fondations, il faut le faire des superstructures. Dans le capitalisme c’est l’État, qui, dans le totalitarisme contemporain, réunit sous sa coupe tous les pouvoirs administratifs, juridiques, financiers, médiatiques, coercitifs, par lesquels il s’efforce d’organiser la survie catastrophique du capital sénile. Aussi, dans le processus communiste, les prolétaires ont pour premier objectif stratégique de détruire cet État pour pouvoir se doter eux-mêmes des pouvoirs qui leur permettent d’engager ledit processus.
Évidemment il faut une organisation puissante pour mener et gagner cette première grande bataille. Elle ne se décrète pas. Pas plus qu’elle ne peut être construite en répétant à satiété : il faut s’organiser, il faut s’unir. Car les questions sont : avec qui ? pour quoi faire ? Créer le MOU55 parce que les temps sont durs ? Encore faudrait-il être d’accord sur les causes de cette dureté pour l’être sur les moyens d’y remédier.
Ainsi, comme nous l’avons vu, l’unité dont les prolétaires ont besoin, y compris pour améliorer leur sort immédiat, ne peut pas être fondée sur l’illusion d’une relance de la croissance du capital qui réduirait le chômage et qui, par un meilleur partage des revenus, élèverait quelque peu le niveau de vie des travailleurs. Elle ne peut pas se fonder sur le nationalisme et le protectionnisme. Elle ne peut se fonder que sur le constat de la réalité, telle que résumée au chapitre 1, et sur les nécessités et possibilités qui en découlent – notamment une baisse drastique du temps de travail contraint, un partage de ce travail et des revenus entre tous, le temps libre comme moyen de développer une libre activité (à commencer par la lutte communiste), un travail riche en même temps que des besoins riches.
Unifier, c’est lutter ensemble, donc avoir un but commun, au-delà de la concurrence, des corporatismes, des nationalismes. C’est donc aussi tracer une nette ligne de démarcation entre ceux qui veulent se borner à améliorer le capitalisme, et ceux qui veulent le combattre pour l’abolir. « C’est seulement en faisant surgir une contre-révolution compacte, puissante, en se créant un adversaire et en le combattant que le parti de la subversion a pu enfin devenir un parti vraiment révolutionnaire »56. Cet adversaire, c’est l’État, qui est l’organisation en classe de la bourgeoisie, tout comme « un parti vraiment révolutionnaire », un parti donc qui lutte contre cet État, est l’organisation en classe des prolétaires.
Certains disent que les prolétaires sont à tout jamais complètement englués dans le rapport salarial et la « société de consommation ». Ils en resteraient donc toujours à l’idéologie et aux comportements réformistes propres au « vieux mouvement ouvrier » cherchant à obtenir de l’État protection et avantages matériels. Ce qu’ils oublient – outre bien sûr le fait qu’il a toujours existé des fractions révolutionnaires chez les prolétaires – c’est que les circonstances qui permettaient au vieux mouvement ouvrier de prospérer ont aujourd’hui changé, et nous n’en sommes d’ailleurs qu’au début.
Autrefois, jusqu’à environ la deuxième moitié du XXe siècle, la productivité (le « développement des forces productives ») était insuffisante, même dans les pays dits développés (plus ou moins suivant ces pays), pour qu’il soit possible à une révolution politique victorieuse de réduire suffisamment la quantité de travail contraint afin qu’elle ne pèse plus comme un fardeau paralysant sur toute la vie des prolétaires, occupant l’essentiel de leur temps. Autrement dit le prolétaire n’avait pour espoir possible dans sa vie « que » l’amélioration de ses conditions de travail (et d’abord d’en avoir un), de ses conditions d’existence en tant que prolétaire, c’est-à-dire dans le cadre alors indépassable du rapport salarial. Cela a été une détermination essentielle de toutes les révolutions des XIXe et XXe siècles en Europe (par exemple 1848 et 1871 en France, 1917 en Russie)57. Tout au long du XXe siècle et jusque vers le début des années 70, les hausses importantes de productivité ont permis au capitalisme de satisfaire en partie, dans les pays impérialistes, à cette demande des travailleurs d’amélioration de leur sort matériel – à l’exception bien sûr de la période de la grande crise des années 30 (elle-même marquée aussi cependant en France par les conquêtes des grèves de 1936).
Quitte à devoir passer sa vie enchaîné à un travail prolétaire, autant qu’il soit le mieux rémunéré possible. Tant que les prolétaires ne pouvaient pas espérer une forte diminution de la quantité de travail contraint – travail dévolu à leur classe – et de sa domination sur leurs vies, mais qu’ils pouvaient en revanche raisonnablement espérer améliorer leurs conditions matérielles d’existence, augmenter leur niveau de consommation – même si ce n’était que peu relativement à l’accumulation du capital, et donc de ses revenus, du côté de la bourgeoisie – leurs luttes restaient, majoritairement du moins, dans les limites du réformisme. D’autant plus que prospérait nécessairement dans cette situation l’influence des organisations du « socialisme vulgaire » démultipliant la puissance de cette idéologie dans le mouvement ouvrier (le « vieux mouvement ouvrier »). L’État, en tant que fonctionnaire du capital en général organisait, avec l’aide de ces organisations appelées à cogérer avec lui les rapports sociaux, ce mode de reproduction du capital, et de la société capitaliste, qui culmina dans les « Trente Glorieuses » d’après-guerre. Ce qui, bien évidemment, semblait justifier le fétichisme de l’État et, par là, le renforçait puissamment dans l’esprit des travailleurs et dans les comportements qui en découlent.
Or la situation a aujourd’hui si considérablement changé que les deux fondements objectifs du vieux mouvement ouvrier réformiste ont été renversés. En effet :
Un premier changement est que le capital sénile ne peut plus rien accorder aux prolétaires. Il ne peut au contraire, comme nous l’avons vu, qu’organiser une dégradation de leur situation, simplement plus ou moins ample, plus ou moins rapide, en fonction du niveau des résistances que les prolétaires lui opposeront en restant sur le terrain du vieux mouvement ouvrier. Mais justement l’État doit, lui, pour reproduire la société capitaliste, nécessairement organiser et faire appliquer ce « réformisme à l’envers » qui consiste à financer toujours plus le capital (pardon, « les entreprises », ça fait plus neutre, plus « tous ensemble dans le même bateau »), et donc enrichir les divers types de capitalistes, tout en « flexibilisant » et appauvrissant toujours davantage les masses populaires. C’est là, très palpable, très visible, une base pour entreprendre de « défétichiser » l’État58, en contrant les intenses efforts inverses des organisations type FG ou FN, et pour construire une possible unité des prolétaires se forgeant contre l’État.
Un deuxième changement, dont la cause, comme pour le précédent, est dans les hauts niveaux de productivité atteints, est l’extraordinaire diminution de la quantité de travail contraint nécessaire pour produire les marchandises (utiles, inutiles, nuisibles, on n’en discutera pas ici). Diminution qui pourrait rapidement être décuplée par une révolution politique permettant d’éliminer rapidement toutes sortes d’activités rendues inutiles, de gaspillages, puis de transformer le système des besoins et des productions. Bref, ce changement est que, pour la première fois dans l’histoire, il est parfaitement raisonnable d’envisager la possibilité de la fin de la domination du travail contraint sur la société. Et donc, évidemment, la fin du type de besoins et de revendications salariales que cette domination déterminait, particulièrement sur les prolétaires qui assumaient l’essentiel de ce travail.
Dire que le développement d’une lutte des prolétaires contre l’État et pour une diminution drastique du temps de travail contraint a aujourd’hui, et contrairement aux siècles précédents, des bases objectives extrêmement solides, n’est pas dire pour autant que la majorité des prolétaires vont d’emblée, quasi automatiquement, changer leur compréhension de la situation et leurs comportements, abandonner l’idéologie et les luttes de type réformiste qu’ils menaient, et mènent encore aujourd’hui, dans la tradition du « vieux mouvement ouvrier ». En effet, l’idéologie peut survivre assez longtemps aux fondements objectifs qui l’ont engendrée. Et c’est là que les communistes ont un rôle particulier à jouer : faire ressortir ces conditions objectives que la crise révèle à travers ses manifestations concrètes, montrer les nécessités et possibilités qu’elles impliquent pour que les prolétaires s’extirpent des processus de dégradation de leur situation que la survie du capital, via son État, lui impose de leur imposer.
Cela ne veut pas dire qu’ils dédaignent les luttes menées actuellement, encore dans la continuation du vieux mouvement ouvrier, sous prétexte qu’elles sont purement défensives (pas plus qu’ils ne seraient les partisans d’une sorte de « tout ou rien », comme si l’abolition du capitalisme n’était pas un processus révolutionnaire complexe). S’efforcer de survivre, amortir les coups est ce que tout individu menacé est amené naturellement à faire. Mieux vaut vendre sa peau le plus cher possible que pour pas un rond ! Cela présente d’ailleurs aussi l’intérêt, lorsque ces luttes sont vigoureuses (grèves dures, émeutes), de gêner le capital dans son offensive contre les travailleurs, et de faire mieux voir le rôle de l’État à son service.
Mais aussi pourquoi continuer à vouloir vendre sa peau quand le capital ne peut plus l’acheter, ou alors à des conditions minables, invivables ? Mieux vaut la sauver en anéantissant ce rapport d’achat-vente déshumanisant, qui ne fonctionne même plus, et que seule la propriété capitaliste des moyens de production rend obligatoire. Anéantissement qui est devenu non seulement absolument nécessaire, mais possible. Et c’est cette solution que les communistes, loin de se contenter de soutenir le mouvement prolétaire tel qu’il est aujourd’hui, et donc tel qu’il court à l’échec, s’attachent à faire prévaloir.
Ce n’est évidemment que sur la base d’expériences multiples et répétées que de plus en plus de prolétaires seront amenés à rompre avec la vieille lutte réformiste, dans son contenu comme dans ses formes, et ressentiront le besoin de construire un nouveau mouvement, une nouvelle organisation qui soient adaptés aux nécessités et possibilités des nouvelles circonstances. C’est sur cette base que peut se développer l’indispensable fusion-transformation réciproque de la théorie et de la pratique, travail qui caractérise le rôle spécifique des communistes dans le processus révolutionnaire.
Nous avons vu que la crise pousse, et poussera encore davantage, l’idéologie et la pratique bourgeoises vers leurs extrémités « populistes » et totalitaires. C’est pourquoi, parce que ces extrémismes politiques deviennent influents dans les masses populaires, y compris chez de nombreux prolétaires, il convient de s’attacher particulièrement à les critiquer, combattre et éradiquer. L’antagonisme entre eux et les communistes porte sur de très nombreux points, dont nous avons seulement évoqué les principaux dans les chapitres précédents. Mais en ce qui concerne le moyen politique de résoudre la crise, de satisfaire les besoins des peuples, il peut se résumer, pour simplifier, en une formule : changer le personnel dirigeant l’État ou briser cet État pour changer le système politique et social de fond en comble.
Déjà, un peu partout dans le monde, des manifestations massives, des émeutes récurrentes montrent que les peuples mettent en cause les pouvoirs en place. Ce n’est pas qu’ils s’attaquent déjà à l’État en tant que tel, mais aux gouvernements, et aussi aux méthodes totalitaires, pacifiques aussi bien que militaires, de la domination du capital mondialisé sur les peuples. Ces attaques sont évidemment liées aux revendications matérielles que la crise fait surgir dans les peuples et que ces gouvernements non seulement ne peuvent pas satisfaire, mais auxquelles ils opposent une brutale répression. Passer au stade supérieur d’une lutte contre l’État, pour le détruire, est aussi un développement des luttes pour des revendications sociales, pour des besoins dont les prolétaires se rendront compte qu’ils ne pourront les satisfaire que par eux-mêmes, qu’en se dotant de leur propre puissance politique, médiatique, armée. De toutes les diverses classes ou couches sociales qui se mettent aujourd’hui en mouvement, seuls les prolétaires n’ont aucun intérêt à vouloir la survie du capitalisme, qui signifierait aujourd’hui pour eux tous, ou presque, une absolue paupérisation. Seuls ils n’ont aucun intérêt à vouloir une reprise de la croissance du capital dont ils seraient les premières et plus grandes victimes, les victimes absolues.
Les revendications immédiates qui peuvent et doivent unir les prolétaires portent évidemment sur tous les domaines de leurs vies, tous étant dégradés par la sénilité du capital. Mais on peut citer comme essentiels pour eux les questions du chômage, des conditions de travail (flexibilité, précarité, intensité du travail), du contenu du travail lui-même (abrutissant, répulsif, « travail de merde »), des salaires et plus généralement du partage des richesses (question du logement notamment). Dans toutes ces luttes une tâche spécifique des communistes est de montrer que leur succès n’est pas dans l’acceptation d’accords de compétitivité qui, soi-disant, sauveraient tels ou tels emplois particuliers, pas dans la recherche d’une illusoire nouvelle croissance du capital, pas dans la puissance de l’État du capital, et quel que soit son personnel dirigeant, mais dans une révolution politique des prolétaires unis et organisés pour détruire cet État et le remplacer par leur propre pouvoir, dans le cours d’un processus communiste d’appropriation des conditions de la construction de leurs vies59.
Les prolétaires n’obtiendront rien de cet État, puisque le capital est dans une situation de sénilité telle que, bien que maître des moyens de production, il ne peut plus les utiliser suffisamment en tant que capital, ce qui veut dire en même temps qu’il tend à ne plus pouvoir faire exister la condition de prolétaire que comme misère absolue, misère trop souvent mortelle. C’est pourquoi ceux-ci n’obtiendront que ce dont ils se rendront eux-mêmes possesseurs. Ce qui est en quelque sorte réaliser une « vraie démocratie » : agir par soi-même, au lieu de déléguer à des puissances extérieures, donc agir avec les autres, puisque c’est avec eux seulement qu’on peut en conquérir les moyens matériels et intellectuels, c’est dans l’association que l’individu élève sa propre et singulière puissance personnelle, sa liberté. C’est déjà ce que tentent de pratiquer plus ou moins les manifestations et émeutes d’aujourd’hui, refusant d’être coiffées et instrumentalisées par les organisations (partis, syndicats), complètement déconsidérées, du système étatique. Néanmoins cela reste encore des tentatives confuses et rencontrant vite leurs limites. Refuser toute organisation au nom d’une démocratie qui serait les masses s’auto-dirigeant parce que « horizontale », sans aucun centre dirigeant, c’est ignorer que la seule puissance, la seule liberté, donc la seule démocratie qui soit aujourd’hui possible aux « indignés » et aux révoltés, c’est une organisation révolutionnaire capable d’unifier et d’élever la compréhension et la pratique de ses membres, capable d’affronter la guerre de classe.
Et il s’agit bien d’une guerre, avec tout ce que cela implique comme formes d’organisation60. Car si les États ne peuvent plus rien pour améliorer le sort des prolétaires, ils peuvent encore beaucoup dans le domaine de la répression bureaucratique, policière, armée, et doivent la mettre en œuvre, les circonstances les obligeant à un totalitarisme de forme ouvertement et massivement brutale, à abandonner leurs derniers oripeaux démocratiques, à supposer qu’ils en arborent encore quelques-uns.
Ce n’est d’ailleurs pas qu’un signe de force, mais aussi de faiblesse. En effet il manifeste que la base des États dits démocratiques dans la société civile, à savoir l’alliance qu’organise et forme l’État entre la haute bourgeoisie et diverses catégories sociales (des fameuses et fumeuses « couches moyennes » jusqu’aux couches populaires les plus modestes), sous la direction de la première, s’effrite, se délite. Que l’ensemble des appareils et organisations (partis, syndicats, parlement, etc.) qui exercent la fonction spécifique de médiatiser les rapports du peuple avec l’État (de jouer le rôle de représentants du peuple dans l’État en même temps que d’être en réalité surtout l’État dans le peuple), de contrôler et borner ses luttes revendicatives, sont largement déconsidérés et même vomis. C’est le délitement d’une forme de domination « pacifique »61, d’un certain consensus « républicain ». C’est donc une crise de l’État, vouée à s’approfondir avec la crise économique. C’est donc aussi qu’arrive le moment d’exploiter cette situation pour faire grandir la lutte contre l’État, d’appuyer ce délitement, pour commencer, au lieu de vouloir le contrecarrer en chantant les louanges d’un État rénové par le nettoyage du « coup de balai », tout en faisant valoir la nécessité et la possibilité d’engager le processus de la lutte communiste évoqué ci-dessus, seul capable de répondre d’abord aux besoins les plus immédiats du peuple, ceci n’étant que le début d’une période de luttes (de transition au communisme) pour en finir avec le capital, avec la condition de prolétaire.
La crise politique, c’est maintenant. Pour les prolétaires en particulier, choisir de s’en remettre encore plus à l’État du capital, gouverné par des extrémistes bourgeois (de type FN ou FG), ou construire leur propre puissance, c’est le choix de maintenant. Hic Rhodus, hic salta ! C’est maintenant qu’il faut y aller !

